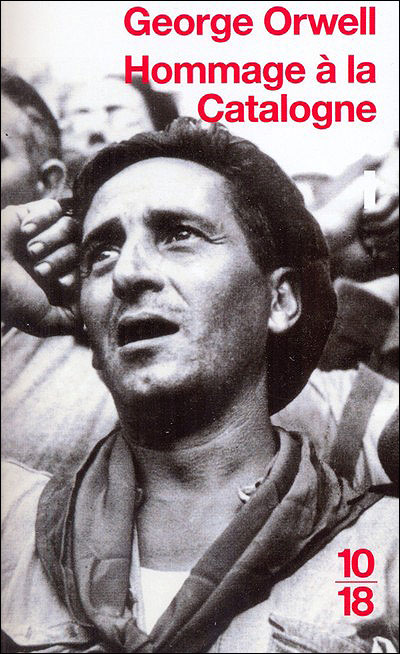J‘écrivais à tort dans un précédent article sur la « Confession de Stavroguine » (chapitre des Démons ou des Possédés qui ne fut publié qu’en 1922*), que Dostoïevski n’était pas particulièrement intéressé par la peinture**. Non seulement ce n’est pas le cas (je reviendrai bientôt sur le Christ mort de Holbein dans L’Idiot), mais cet auteur a une façon bien à lui de pratiquer l’ut pictura poesis : à la différence de la plupart des écrivains, en effet, il n’instrumentalise pas la peinture pour « faire voir » un spectacle extérieur. L’Acis et Galatée de Claude Lorrain, admiré à Dresde par Stavroguine, fonctionne à la fois comme clé et vecteur d’une révélation ontologique. Tapi dans l’inconscient du personnage, il est au coeur d’une anamnèse. Les héros de Dostoïevski ont une étonnante faculté d’oubli mais pour peu que s’ouvre une brèche dans leur dispositif de défense, ce qu’ils ont refoulé (la mort d’une enfant ici, comme pour le Veltchaninov de L’Eternel mari) engendre un malaise intolérable. Dans les Démons, c’est la remémoration, via le rêve, de la toile du Lorrain qui soudain donne accès à ce qui semble avoir été jusque-là refoulé ou « censuré » (c’est le mot même du personnage) même si un aveu explicite figure sans doute dans le feuillet supprimé de la confession.
Dostoïevski ne décrit pas un tableau que chacun peut voir, il l’évoque (« des flots bleus et caressants, des îles et des rochers, des rivages florissants ; au loin un panorama enchanteur, l’appel du soleil couchant« , traduction Boris de Schloezer) ) en faisant revivre à Stavroguine le faisceau complexe des émotions qu’il avait autrefois retirées de sa vision de l’oeuvre. Entrée dans son musée imaginaire sous un autre nom (« moi je l’appelais, je ne sais pourquoi, l’Âge d’or ») elle resurgit pourtant « non comme un tableau […], mais comme une réalité ». Comprenons : non comme un pur spectacle mais comme une expérience, qui en recouvre une autre, nettement moins avouable que l’émotion esthétique procurée par une oeuvre d’art. De façon révélatrice, le cadre, l’atmosphère idyllique de la scène mythologique prennent le pas sur l’histoire d’Acis et Galatée, dont l’issue funeste est pourtant inscrite dans le tableau. Stavroguine ne veut d’abord se souvenir que d’un intemporel « Ãge d’or », symbole de l’innocence perdue de l’humanité entière :
« Les paroles ne peuvent décrire cela. C’est ici que l’humanité européenne retrouve son berceau ; ici que se déroulèrent les premières scènes de la mythologie ; ce fut son vert paradis. Ici vécut une belle humanité. Les hommes se réveillaient et s’endormaient heureux et innocents ; les bois retentissaient de leurs gaies chansons ; le surplus de leurs forces abondantes s’épanchait dans l’amour, dans la joie naïve. Le soleil versait ses rayons sur ces îles et sur la mer, et jouissait de ses beaux enfants. Vision admirable ! Illusion splendide ! Rêve le plus impossible de tous et auquel l’humanité a donné toutes ses forces, pour lequel elle a tout sacrifié, au nom duquel on mourut sur la croix, on tua les prophètes, sans lequel les peuples ne voudraient pas vivre, sans lequel ils ne voudraient même pas mourir ».
Or cette plénitude, c’est au présent que le rêve la lui restitue avec une puissance de suggestion incomparable et presque douloureuse qui abolit le temps. Ce n’est plus d’une « humanité » abstraite qu’il s’agit, mais de lui-même. Sa propre chambre est subitement ressuscitée : le soleil couchant, les fleurs, le cadre fleuri de la fenêtre étaient comme contenus dans l’image picturale :
« Dans mon rêve il me sembla vivre tout cela […] — tout cela il me semblait encore le voir quand je m’éveillai et ouvris les yeux, pour la première fois de ma vie, littéralement trempés de larmes. La sensation d’un bonheur encore inconnu me traversa le cœur ; j’en eus même mal. C’était déjà le soir ; à travers la fenêtre de ma petite chambre, à travers la verdure des fleurs qui garnissaient la fenêtre, le soleil couchant dardait un faisceau oblique d’ardents rayons et me baignait de lumière ».
Mais justement telle est l’intensité de la réminiscence qu’elle balaie ce tableau d’un bonheur suspendu hors du temps et « remet en marche » le cours dénié de l’histoire. Bientôt, l’amant de Galatée sera écrasé sous une pierre par Polyphème (cf. Ovide, Métamophoses, 13, 882-92). Quoique à peine visible, la menace est bien présente à la droite du tableau : dissimulé sous le feuillage, le Cyclope joue de la flûte sur une colline dominant la mer. De la même façon, quelque chose de menaçant et d’atroce, tapi dans le récit de Stavroguine, le court-circuite, cependant qu’une lumière aveuglante ressuscite partiellement le souvenir refoulé :
« Je refermai rapidement les yeux, comme pour essayer d’évoquer encore une fois le rêve disparu, mais soudain je distinguai, au milieu d’une lumière vive, très vive, une sorte d’image et tout à coup je vis très distinctement la petite araignée rouge. Je la reconnus, immédiatement, telle que je l’avais contemplée sur la feuille de géranium tandis que le soleil couchant déversait ses rayons obliques. Quelque chose d’aigu pénétra en moi ; je me soulevai et m’assis sur le lit. »
Voilà sans doute pourquoi l’oeuvre du Lorrain refait surface au plus fort de la crise où se débat le héros des Démons. Certes, nous ne saurons pas ce qui était inscrit sur le feuillet soustrait à la liasse qu’est en train de lire le moine Tikhon. Nous n’avons que le rêve du tableau et la terreur qu’il finit par engendrer, ainsi que ce demi-aveu : « je suis prêt à abandonner mon corps à toutes les tortures pour que cette chose ne se soit pas produite ce jour-là » et cette déclaration sibylline : « C’est ainsi que cela commença » (je souligne).
Sous l’effet du déplacement propre au rêve, la petite araignée rouge, valant métonymiquement pour le « crime », se substitue à ce qui ne peut ni se dire (« cette chose », « cela »), ni se représenter. Le rêve pictural a fait émerger ce qui était refoulé mais surtout il révèle à Stavroguine l’étendue et la signification de son acte : en sacrifiant la petite Matriocha, c’est non seulement l’innocence qu’il a anéantie mais surtout ce que lui avait brièvement rendu le rêve du tableau : la « sensation d’un bonheur encore inconnu« . Juste avant que le récit ne s’interrompe en effet, l’enfant mal-aimée lui avait manifesté une affection inattendue :
« Les fenêtres étaient garnies de géraniums ; le soleil était ardent. Je m’assis silencieusement à côté d’elle, sur le plancher. Elle tressaillit, eut épouvantablement peur au premier instant et se dressa brusquement. Je pris sa main et l’embrassai, la fis se rasseoir sur son banc et la regardai fixement dans les yeux. Que je lui eusse embrassé la main — cela la fit rire comme une enfant ; mais un instant seulement, car elle se dressa de nouveau, saisie d’une telle épouvante qu’une convulsion passa son visage. Elle me regarda avec des yeux atrocement fixes, tandis que ses lèvres se mettaient à trembler comme si elle allait pleurer. Mais elle ne cria pourtant pas. Je lui embrassai encore une fois la main et la pris sur mes genoux. Elle eut alors un mouvement subit de recul et sourit honteusement, mais d’un sourire oblique. Tout son visage rougit de honte. Je ne cessai de rire et de lui murmurer quelque chose. Enfin, il se produisit une chose si étrange que jamais je ne l’oublierai et qu’elle me frappa d’étonnement. La petite fille entoura mon cou de ses deux bras et se mit elle-même à m’embrasser ardemment. Son visage exprimait le ravissement. Je me levais presque furieux ; cela m’était désagréable de la part de ce petit être, et puis, j’eus aussi subitement pitié… »
Le « crime » de Stavroguine est-il, comme le dit souvent, d’avoir violé Matriocha? Je ne le crois pas. Mais il n’a pas compris son appel, a pris pour des « avances » son élan de tendresse, saccageant un bonheur qui aurait pu être et faisant de l’enfant aimante une petite créature « amaigrie, les yeux fiévreux […] avec son petit poing levé et menaçant« . Et c’est le tableau du Lorrain qui a comme libéré « l’aspect qu’elle avait à cette minute, rien que cet instant, rien que ce hochement de tête », lequel apparaît désormais « presque chaque jour » à Stavroguine : « Elle n’apparaît pas d’elle-même, mais je l’évoque et je ne peux pas ne pas l’évoquer et je ne peux pas vivre avec cela. Oh ! si je pouvais la voir une fois réellement, au moins en hallucination !« .
Je disais en commençant que Dostoïevski confère à la peinture une fonction inhabituelle. Elle n’est pas chez lui au service de la narration (« ancilla narrationis« ) comme chez Balzac par exemple. Elle est – tels le rêve ou l’hallucination, parfois la maladie – le vecteur non verbal d’une vérité enfouie, qu’elle aide à mettre au jour. On trouve quelque chose de ce genre chez Bonnefoy (dans Le Digamma par exemple, ce « récit en rêve » où il est question des Bergers d’Arcadie de Poussin, tableau également aimé de Dostoïevski). Il faudra voir si cette hypothèse se confirme à propos du Christ mort, copie de l’oeuvre de Holbein que le jeune Hippolyte Terentiev se souvient d’avoir vue chez Rogojine et qui lui inspire cette interrogation vertigineuse : « Est-il possible de percevoir dans une image ce qui n’a pas d’image » (L’Idiot, tome 2, IIIe partie, chapitre 6, éd. Babel, trad. André Markowicz, p. 146).
- Dans L’Adolescent le passage censuré est repris avec des connotations différentes. Pour Versilov, le soleil couchant du tableau du Lorrain annonce l’incendie des Tuileries lors de la Commune.
** C’est d’ailleurs le point de vue général sur Dostoïevski, comme le fait remarquer Michel Cadot dans son article « Peinture et fiction chez Dostoïevski » in Les Fins de la peinture, sous la direction de René Démoris, éd. Desjonquières, 1990. Le fait est que la peinture ne tient pas, chez Dostoïevski, la place qu’elle occupe chez d’autres auteurs de son temps. Cependant un nombre limité de tableaux a exercé sur lui une véritable fascination, notamment la Madone Sixtine de Raphaël, également vue à Dresde. Dans Crime et Châtiment (VIe partie, chap. 6), Svidrigaïlov qualifie l’expression de la Vierge de « fantastique et hallucinée ».